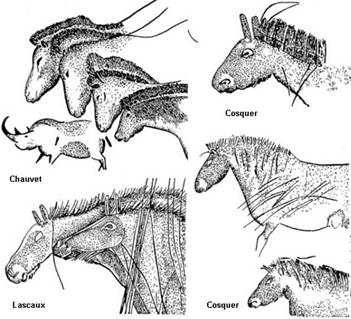Février 2017 Retour
Les
avis de la communauté scientifique sur la datation de la grotte Chauvet
Extrait de : Nouvelles recherches sur l’identité
culturelle et stylistique de la grotte Chauvet et sur sa datation par la
méthode du 14C. Jean Combier et Guy Jouve. Paru dans
L’anthropologie 118 (2014).Pages 87-94.
Article de Combier
- Jouve (résumé)
« La découverte de la grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d’Arc
(Ardèche), en 1994, a marqué une date importante dans la connaissance de l’Art
pariétal paléolithique dans son ensemble. Ses représentations peintes et
gravées par leur nombre (425 unités graphiques) et leur excellente conservation
offrent un thesaurus documentaire comparable à celui des plus grands sites
connus, bien supérieur à ce qu’avait déjà donné le groupe des cavernes
rhodaniennes (Ardèche et Gard). Mais précisément son étude, si on la replace
dans son cadre naturel régional, culturel et thématique, ne permet pas d’y voir
une entité isolée et d’une précocité surprenante. Elle est à reconsidérer et
les affinités que nos recherches ont fait apparaître sont nettement en défaveur
de l’âge très ancien qui lui a été attribué. Si l’on étend cet examen à
l’ensemble du domaine franco-cantabrique, une évidence s’impose : la grotte
Chauvet, si elle présente des caractères qui lui sont propres (comme chaque
grotte ornée), se situe dans une phase évolutive de l’art pariétal très
éloignée de ses formes d’origine (connues par l’art sur blocs et sur parois
d’abris datés en stratigraphie de l’Aurignacien, en France et en Espagne
cantabrique). Elle se place donc très normalement, pour la majorité de ses
œuvres, dans le cadre des créations artistiques bien définies du Gravettien et
du Solutréen. Cette phase du Paléolithique supérieur moyen (26 000-18 000
ans) coïncide d’ailleurs avec une occupation humaine locale particulièrement
intense et diversifiée, inconnue auparavant et beaucoup moins dense ensuite, au
Magdalénien. Une critique serrée du traitement des échantillons soumis à
l’analyse AMS du radiocarbone, ne permet pas de retenir l’âge très ancien (36 000
ans cal BP) attribué par certains auteurs aux figures peintes et gravées de la
grotte Chauvet. »
Les
avis des spécialistes (résumés
ou extraits)
Christian
Züchner indique
qu’il fut le témoin du revirement de Jean Clottes. C'était au Museum de Monrepos (Neuwied, Allemagne) au moment où ce dernier reçut
les résultats du radiocarbone. « A cet instant, il rejeta ses précédentes
datations, la grotte Chauvet est devenue une grotte sanctuaire de
l'Aurignacien : je rencontrai mon ami et collègue Jean Clottes à Monrepos et j’ai essayé de parler avec lui des problèmes
qui en résultent, mais sans succès. En conséquence, je décidai de publier mes
principales objections dès que possible afin de motiver une discussion
impartiale. J'ai continué à présenter mon argumentation critique dans les
journaux et des conférences au cours des années suivantes. Seuls quelques
collègues en Espagne, Angleterre et en France ont ajouté de nouveaux arguments
convaincants contre le grand âge. Combier et Jouve
donnent un compte rendu détaillé de ces efforts. Pendant ce temps, l'âge
Aurignacien est devenu une sorte de dogme, qui est accepté partout dans le
monde. Mon argumentation bien-fondée fut rejetée très
durement par l'équipe de recherche au cours du colloque d'Aurignac en 2005. »
Se fonder sur des critères stylistiques
pour établir une chronologie n’est démenti par aucune grotte, sauf la grotte
Chauvet si l’on croyait aux dates de l’équipe officielle. Pour lui comme pour
Jean Combier, les peintures noires ont beaucoup de
points de comparaison avec les œuvres de la grotte de Lascaux. Il ajoute qu’il
existe des arguments forts montrant que l’art de la grotte s’est poursuivi
jusqu’au Magdalénien, même si un nombre très restreint d’œuvres archaïques dans
la première partie de la grotte pourraient dater de l’Aurignacien. Il conclue
que beaucoup de travaux restent à faire pour comprendre la chronologie de la grotte.
Michel Lorblanchet signale tout d’abord que l’art
aurignacien dans la région du Sud-Ouest n'a guère de rapport avec l'art de la
grotte Chauvet. Il apprécie tout ce qui a été écrit sur le contexte ardéchois
et rhodanien de Chauvet, l’absence locale d’Aurignacien. Il attendait
particulièrement l’avis sur ce point de J. Combier
spécialiste, notamment, de la préhistoire de cette région. La grande question
pour les préhistoriens étant bien celle des datations ! Il est normal qu’elles
soient discutées et critiquées.
Il insiste sur la nécessité d’associer les analyses des pigments et leur
datation au radiocarbone. Il rappelle
qu'en 1995, il écrivait « les datations
de pigments doivent être intégrées à une étude complète du site incluant celle
des parois et de leur contexte. Elles doivent en particulier être
systématiquement associées aux relevés des figurations et aux analyses
physico-chimiques des pigments... prélever des échantillons au hasard n’a
jamais constitué un embryon de méthode scientifique ». Durant toutes ses
recherches, il a scrupuleusement et constamment associé l’analyse des pigments,
les relevés et les datations. Il pense que la partie gravettienne de Chauvet a
pu être sous-estimée par Combier-Jouve, mais la
présence du Magdalénien ne lui semble pas établie. En conclusion il note
qu'aucun schéma évolutif solide de l’art pariétal quaternaire ne peut pour
l’instant s’élaborer tant que règne une incertitude sur la datation de cet
ensemble pariétal hors du commun et que l’article de J. Combier
et G. Jouve, comme ceux de P. Bahn, P. Pettit, C. Züchner, invite à un
débat qui paraît aujourd’hui inévitable.
Michel Martin aborde la chronologie de la grotte
Chauvet « uniquement par le biais de la stylistique et de la thématique
figurée et abstraite qui, indépendamment du recours aux datations
radiométriques, concourent largement à douter de l’âge aurignacien des œuvres
de Chauvet », points qu’il développe dans son article. Il termine
« En guise de courte conclusion à ces quelques réflexions, nous adhérons
pleinement et depuis plusieurs années, en fait depuis notre visite de la grotte
Chauvet en 2002, à la thèse soutenue par J. Combier
et G. Jouve. En effet, depuis cette date et suite à la visite de nombreux
grands sites et de grottes plus mineures, nous avons l’intime conviction, loin
de toute querelle, que les œuvres de Chauvet s’étalent sur un long temps
d’utilisation de ses parois. »
François
Djinjian s’interroge sur les raisons
qui font que la grotte Chauvet est en permanence l’objet de polémiques et de
scandales, qui concernent aussi bien les inventeurs, les propriétaires, les
conservateurs et les chercheurs. « Il est clair que J. Clottes maîtrise
mal les difficultés de l’art pariétal et de sa datation. Son obstination et
celle de ses successeurs malgré les difficultés soulevées ici et là, trahit
bien cette faiblesse, alors que la Science moderne peut résoudre la question
sans polémique et en y intégrant tous les acteurs. Sans doute aussi le fait que
les travaux scientifiques aient été confiés dans le cadre d’un Appel d’Offres
public à un maître d’œuvre qui
n’était autre que le maître d’Ouvrage et le donneur d’ordres ! »
Rodrigo de
Balbín Behrmann, se fondant sur l’examen des styles doute de l’unicité de la période de réalisation
de cet ensemble pictural aux caractères variés. « Analysée comme une unité
par les chercheurs de l’équipe, Chauvet aurait anéanti l’organisation
stylistique d’André Leroi-Gourhan. Par contre, beaucoup de spécialistes se sont
montrés très tôt sceptiques voire franchement contre cette hypothèse d’unicité
du fait de l’absence de corrélations archéologiques et des problèmes posés par
les âges 14C obtenus à partir des restes de charbon de bois pris dans les
foyers. La proposition est intéressante et légitime mais, mise à part la forte
conviction ‘ anti-style ‘, il faut avoir des preuves pour l’affirmer.»
Sa conclusion est que, dans les conditions actuelles des travaux,
la grotte Chauvet « serait plus en accord avec des périodes plus récentes,
avec des analyses de composition des échantillons, avec une analyse du matériel
archéologique plus approfondie et avec une interprétation plus libre et
indépendante des critères anti-stylistiques. »